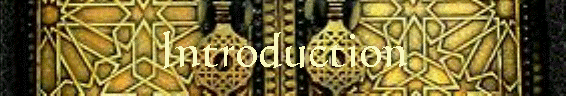
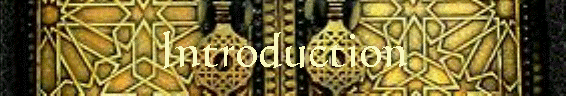
 |
Par David OUANOUNOU
L’héritage musical du peuple d’Israël est caractérisé par trois mille ans d’histoire et par l’impressionnante variété de ses constituants. De nombreuses cultures musicales sont à l’arrière-plan de son évolution : celles des civilisations antiques et helléniques à l’époque des patriarches et des Temples, et celles de tous les pays de la Diaspora pendant environ deux mille ans de dispersion. Devant cette pluralité, une question de principe s’impose : est-il possible de trouver un dénominateur commun à ces éléments apparemment disparates permettant de les réunir sous un même toit ? |

|
Les tentatives de reconstitution de la musique et de la vie musicale à l’époque biblique se fondent principalement sur les nombreuses références contenues dans les écrits bibliques – source la plus riche portant sur les aspects divers de l’activité musicale. Cependant l’interprétation des renseignements ainsi obtenus se heurte à de sérieuses difficultés. Parfois on ne sait pas exactement à quoi correspondent le nom d’un instrument, un terme technique, une tête de psaume, etc. Mais, grâce aux résultats des fouilles archéologiques, aux études philologiques, aux documents extérieurs à la Bible et enfin aux principes et méthodes de l’ethnomusicologie, quelque lumière a été jetée sur une partie des obscurités. La première référence relative à la musique dans la Bible est celle qui attribue l’invention de la musique et de ses instruments à Juval (Genèse, IV, 21). Pendant l’époque nomade et jusqu’à l’institution de la royauté, la musique mentionnée est de nature plutôt folklorique. Il s’agit de chants et de danses de guerre et de triomphe, de lamentations, de réjouissances populaires et de l’évocation de thèmes tels que l’eau (le chant du puits : Nombres, XXI, 17-18), sujet de préoccupation dans cette contrée. À l’exemple de la société bédouine, la femme occupa une place importante dans ce genre de manifestations (Tzila, Myriam, Deborah, la fille de Jephté). La forme d’exécution prédominante semble être celle du chant résponsorial. Le style responsorial actuel, très en faveur dans la musique folklorique du Proche-Orient, permettrait d’imaginer ce qu’il fut autrefois. La musique de cette époque a servi aussi à d’autres fins, notamment à exalter les prophètes, et comme agent thérapeutique (l’effet de la lyre de David sur Saül). Les instruments Les instruments alors en usage sont : le tôf (tambour sur cadre), la hasosrah (trompette), qui servait de signal dans différents buts d’ordre militaire ou cultuel, et le sofâr (corne de bélier), qui servait également de signal à l’occasion ; la sonorité rude de cet « instrument » était de tout temps assimilée à des pouvoirs extra-naturels : le sofâr accentue le sentiment d’effroi lors de la révélation divine sur le mont Sinaï (Exode, XIX, 16), il cause l’effondrement des murs de Jéricho (Josué, VI, 6-20) et il est utilisé comme stratagème de guerre par Gédéon (Juges, VII). Plus tard, quand il deviendra le seul instrument admis dans le culte synagogal, il sera chargé de résonances mystiques tout en conservant son pouvoir magique. Son rôle le plus important consistera dans la lutte contre les forces du mal qui cherchent à empêcher l’homme de se débarrasser de la souillure de ses actes. Il devient aussi puissance capable d’attribuer ou même de forcer la grâce divine. Avec l’institution de la royauté et le développement d’une société sédentaire s’élabore une musique raffinée ; les instruments se perfectionnent, et une classe de musiciens professionnels prend naissance. À ce stade, la musique joue un rôle important aussi bien dans la vie séculière que dans le culte du Temple. Déjà vers la fin de l’époque du premier Temple, la musique occupe une place de choix dans le culte. Du temps du roi David, on comptait quatre mille lévites sachant chanter et jouer d’instruments ; au retour de l’exil, avec Esdras, il y avait trois cent vingt-huit musiciens. Les musiciens du Temple appartenaient à des familles de la tribu de Lévi et étaient organisés en vingt-quatre ensembles groupant douze musiciens chacun. Leurs fonctions se transmettaient de père en fils, et leur art était jalousement gardé. Vers la fin de l’époque du second Temple, il y avait douze chanteurs et douze instrumentistes. L’ensemble orchestral se composait de neuf kinnorôt (lyres), de deux nevalîm (une variété de lyre) et d’une paire de cymbales. Leur répertoire chanté et accompagné était constitué par les psaumes qui représentaient différentes catégories lyriques, différents styles d’exécution – dont le responsorial et l’antiphonal (à quoi il faut ajouter beaucoup d’indications d’exécution énigmatiques) – et un grand nombre d’instruments : le halîl (flûte ou instrument à anche), les minnîm (instruments à cordes), le ‘uggâb (harpe ?), les silselîm (cymbalettes), etc. Le nombre total d’instruments mentionnés dans la Bible est de seize, y compris l’« orchestre » de Daniel qui comprenait des instruments d’origine hellénique. L’influence hellénique se traduit aussi par l’institution des théâtres et par la participation aux jeux de gymnases.
|